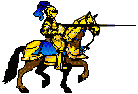|
|
|
|
Chapitre III L'ambiance relativiste, bouillon de culture pour la néo-révolution
Le climat d'insouciance optimiste qui s'est accentué en
Espagne au cours des dernières décennies a créé une situation
particulièrement propice à la révolution du PSOE.
Le peuple espagnol est sorti de la Guerre Civile – comme
les autres pays d'Europe sont sortis de la Guerre Mondiale – sous les effets
du profond traumatisme produit par les souffrances terribles et prolongées
engendrées par le conflit. D'innombrables Espagnols se sont trouvés alors
psychologiquement épuisés, avec un mélange de crainte et de paresse
d'affirmer leurs convictions et de les défendre. Plus ou moins
subconsciemment, ils aspiraient à la chimère d'un monde futur d'où auraient
été extirpées toutes les causes d'affrontement entre les hommes.
A mesure que la prospérité et l'insouciance augmentaient,
dans les années soixante, les Espagnols s'éloignaient de leur passé de foi,
de sérieux et d'héroïsme, et des exigences logiques et morales que celui-ci
impose. Un désir vague, mais réel, d'une Espagne plus en accord avec la
société de consommation, jouisseuse et permissive, ainsi qu'une avidité à se
plonger dans la fruition de ses propres intérêts, se sont généralisés dans
beaucoup de milieux.
Le socialisme et le communisme en retirent deux avantages
inestimables : une diminution progressive du rejet qu'ils recevaient de
l'opinion publique ; et la formation d'un vide psychologique et publicitaire
autour de ceux qui cherchaient à lever l'étendard de l'Espagne catholique,
héroïque et chevaleresque.
Dans ces circonstances, il a suffi au PSOE d'adopter une
image souriante et dialogante, pour pouvoir mettre en marche sa «terrible»
révolution.
1. Un climat relativiste et anesthésiant dans la vie
publique
Tels de nouveaux Kennedy, les hommes publics espagnols
actuels propagent, plus que des idées et un programme, un état d'esprit
optimiste et insouciant. La dévalorisation des principes dans la vie
politique a créé un climat relativiste et anesthésiant qui surprend des
observateurs issus des secteurs idéologiques les plus variés.
«Les moeurs politiques sont ici d'une exceptionnelle
convivialité. Que l'on soit dirigeant du Parti communiste, socialiste, ou de
l'Alliance populaire, on se parle, on se tutoie, on s'invite, on organise
ensemble colloques et séminaires. Tout cela donne l'impression, peu commune
en ce sud de l'Europe, qu'aucun héritage idéologique n'a été transmis», a
commenté un journaliste français
[1].
Dans le même sens, un observateur italien a bien décrit
cette ambiance : «Les socialistes au pouvoir n'exaltent pas leurs succès,
l'opposition ne se déchaîne pas dans la critique. (...) Les jugements sont
beaucoup moins émotifs (...) C'est le sens pratique qui prévaut ; les
'valeurs éternelles' semblent s'être dissoutes. (...) On note une absence
d'animosité, une totale correction, même chez les juges les plus critiques.
(...) Tel est le climat, un climat de tolérance où la vieille dramaticité
espagnole semble désarmée pour toujours»[2].
Le PSOE n'épargne aucun effort pour maintenir le climat de
relativisme anesthésiant nécessaire à sa révolution «tranquille» et
«silencieuse». Ainsi, il s'est arrangé pour éviter le débat public pendant
la campagne électorale de 1986.
Un éditorial de l'ABC commente: «L’opposition a demandé
que soit convoquée la députation permanente de la Chambre des Députés. (...)
Le Groupe Socialiste s'y est refusé... Ce qu'il faut souligner, c’est
l'argument utilisé par le Groupe Socialiste : la réunion de la députation
permanente pourrait déboucher sur un débat qui pourrait altérer le processus
électoral (...) Surtout, ne touchez pas au climat d'atonie qui domine cette
campagne, à la douce anesthésie qui nous endort»[3].
Plus encore, après avoir remporté les élections, le PSOE a
célébré sa victoire silencieusement, pour éviter tout débat.
«Personne n’est plus silencieux que nos socialistes dans
la célébration de leur victoire électorale», constate avec surprise Jaime
Campmany. «Ils ont fait une campagne ennuyeuse et sans contenu. Ils n'ont
pas expliqué leur programme. (...) On a évité soigneusement le débat public»[4].
Sous le gouvernement Suarez, de gauche à droite :
le Nonce à Madrid, Mgr Dadaglio, le Cardinal archevêque de Madrid, Mgr
Tarancon, le président du gouvernement Adolfo Suarez, et le chef du Parti
Communiste, Santiago Carrillo
2. Consensus irénique et relativiste, qui affecte les
adversaires naturels du socialisme
a) l'Episcopat espagnol
L'Eglise est, de soi, la grande adversaire du socialisme.
Laïc et matérialiste, celui-ci contrarie nécessairement l'apostolat de
l'Eglise. Par son caractère égalitaire et collectiviste, il veut imposer à
la société un état de choses diamétralement opposé à la civilisation
chrétienne. Cela n'étonnait personne que d'entendre un Pablo Iglesias,
fondateur du PSOE, proclamer, en cohérence avec ses ruineux principes :
«Nous voulons la mort de l'Eglise (...) c’est pour cela que nous éduquons
les hommes»[5].
L'Episcopat était lui aussi cohérent quand il publiait sa Lettre pastorale
collective de 1937, où il prenait position contre le communisme. Aujourd'hui, cet antagonisme s'est estompé, parce que la position des secteurs les plus influents de la Hiérarchie face au socialisme a changé. En 1971, l'Assemblée Conjointe d'Evêques et de Prêtres réunie à Madrid a approuvé une motion demandant pardon au peuple espagnol pour cette attitude anticommuniste. Depuis lors, l'Episcopat a promu, comme ligne de conduite officielle, une réconciliation entre les Espagnols. Cet objectif est louable en lui-même, mais il ne tient pas compte de ce que le socialo-communisme est intrinsèquement antichrétien et constitue ainsi une grave menace pour l'avenir catholique du pays[6]. On a l'impression que le secteur majoritaire de l'Episcopat estime que la haine sectaire des communistes et socialistes contre l'Eglise de Notre-Seigneur Jésus-Christ ne produit plus d'effets concrets et que, par conséquent, elle ne mérite plus d'être prise en considération[7]. Dans la pratique, cette orientation irénique de la Conférence épiscopale a désarmé les catholiques face aux ennemis de l'Eglise et de la civilisation chrétienne. Ces derniers ne peuvent que s'en réjouir[8].
______________________________________
Entre la vérité et l’erreur, le bien et le mal,
la réconciliation est impossible
Complétant cet enseignement, Pie XII rappelle avec
concision la doctrine de l'Eglise : «Premièrement : ce qui ne correspond pas
à la vérité et à la morale n'a objectivement aucun droit ni à l’existence ni
à la propagande ni à l'action. Deuxièmement : le fait de ne pas l'empêcher
par des lois publiques et par des dispositions coercitives peut néanmoins se
trouver justifié par l'intérêt d'un
bien supérieur et plus universel» (Discours au Ve Congrès National de
l'Union des Juristes Catholiques Italiens, 6/12/53, 17).
Abordant un autre aspect de la question, le théologien
dominicain, R.P. Garrigou-Lagrange, indique une condition pour une
connaissance impartiale et profonde : «La sainte haine du mal est
effectivement - quoiqu'on dise - une lumière nécessaire à l'impartialité.
Pour connaître profondément le bien, il faut l'aimer. Pour savoir
véritablement tout ce qu'est le mal, il faut le haïr» (Garrigou-Lagrange,
Dios II - Su Naturaleza, Ed. Palabra, Madrid, 1980, p. 99, n° 65).
___________________
Un grand promoteur de cette politique de réconciliation,
qui en est même devenu le symbole, a été le cardinal Tarancon, archevêque
démissionnaire de Madrid et ex-président de la Conférence épiscopale
(1971-1983). En 1981, le cardinal a tranquillisé les catholiques devant une
éventuelle victoire socialiste : «Si le PSOE arrivait au pouvoir, cela
n’affecterait en rien l'Eglise espagnole», car «avec des gouvernements moins
catholiques, l'Eglise vit mieux». Finalement, il a déclaré: «l'Eglise
espagnole a été, depuis le Concile et dans les dernières années du régime
antérieur, de gauche»[11].
Des affirmations plus récentes de l'archevêque de Sarragosse, Mgr Elias
Yanes, reflètent la même orientation. Selon ce prélat, la prédication de la
doctrine sociale de l'Eglise à partir de Jean XXIII a entraîné un grand
nombre de catholiques à voter pour les candidats du PSOE[12].
Le résultat a été qu'en Espagne - ô paradoxe ! - «ce sont
les non catholiques qui gouvernent, grâce précisément au vote catholique»[13].
b) les leaders politiques de forces contraires au
socialisme
La plupart des leaders politiques ont aussi collaboré à la
démolition des barrières doctrinales, psychologiques et morales face au
socialisme. L'ancien secrétaire général du principal parti de l'opposition,
Alianza Popular, Jorge Verstrynge a affirmé qu'il ne cherchait pas la
défaite du socialisme. Pour lui, le plus important était presque le
contraire : travailler pour le triomphe d'une mentalité irénique
pro-convergence qui considère le socialisme non pas comme un adversaire,
mais comme l'une des deux moitiés saines et complémentaires de la vie
nationale : «La question est la nouvelle mentalité dont nous tous,
Européens, avons besoin», disait Verstrynge. «Il faut arriver à des
attitudes qui soient authentiquement d’intégration et non de réduction. Une
intégration authentique ne sera pas obtenue en excluant le contradictoire
(...). Pour cela, il faut que la droite et la gauche ne soient pas
considérées comme s’excluant, mais, de façon pluraliste, comme
complémentaires»[14].
Manuel Fraga Iribarne, ex-président du parti en question,
s'est lui aussi exprimé dans des termes analogues. Le chef de l'AP ne semble
pas désirer une défaite écrasante du socialisme, parce qu'elle empêcherait
ce dernier de tenir une place importante dans le jeu politique : «Il me
paraît évident, écrit-il, que la droite (...) en Espagne ne souhaite pas la
disparition du vote socialiste ou sa transformation en un secteur résiduel»[15].
L'actuel président de l'Alianza Popular, Antonio Hernandez
Mancha, a jusqu'à présent évité les définitions qui puissent contraster avec
le consensus irénique et relativiste. Pour lui, «en politique, il n'y a pas
d’idées bonnes ni mauvaises, tout dépend de leur situation dans un contexte
déterminé»[16].
Son critère est particulièrement déconcertant pour les questions politiques
ayant des implications morales. On a du mal à le comprendre chez un homme
qui représente les aspirations du centre-droit : «J'ai toujours dit que,
dans les matières où la politique touche la morale, nous devons suivre à un
pas l’évêque le plus progressiste»[17].
Néanmoins, comme il n'est pas depuis longtemps à la tête du parti, on ne
peut affirmer qu'il ait déjà adopté son image définitive.
Nous avons laissé pour la fin le caméléon de la politique
espagnole, l'ex-président Adolfo Suarez. L'ambiguïté intentionnelle de ce
leader centriste empêche l'opinion publique de savoir nettement ce qui
distingue son parti, le Centre Démocratique Social (CDS), du PSOE. Pour
clore sa campagne électorale de 1986, il a promis : «Nous mènerons à terme
le changement que les socialistes ont promis et n’ont pas accompli (...) Je
me propose la construction du changement socio-économique et des structures
culturelles (...) que Felipe Gonzalez n’a pas su ou n’a pas voulu mettre en
marche»[18].
Cette promesse permet de mieux comprendre sa déclaration à un correspondant
de l'ABC au Chili : «C’est une conception radicale de la liberté [et de]
l'égalité qui nous inspire»[19].
On ne s'étonne pas alors que le directeur de la troupe Els Joglars, Albert
Boadella (auteur de plusieurs pièces blasphématoires et immorales),
manifeste sa sympathie pour le CDS : «ce parti signifie l'absence
d'idéologie, un lieu où tout est possible, et je le soutiendrai parce que
j’aime la confusion au pouvoir»[20].
Le progressisme catholique a adopté une position irénique
et relativiste analogue. L'historien et journaliste J.M. Garcia Escudero, un
des coryphées de cette tendance, propose d'en finir avec les «exigences
artificielles du principe de contradiction» et rêve à un «échappement
dialectique», qui permettrait la convivance des positions contraires et la
disparition des antagonismes.
D'après lui, cette vision philosophique favoriserait
l'avènement de la «troisième Espagne», une Espagne «européenne», où la
droite et la gauche seraient vues comme «parties d’une unité supérieure» ou
comme «deux moitiés d'une unité antérieure perdue»[21].
3. Pour le gouvernement, le «problème fondamental» est
d'en finir avec les «deux Espagne»
Le PSOE ne reste pas en arrière des autres forces qui
poursuivent l'objectif de la réconciliation irénique.
Dans la déclaration officielle pour le cinquantenaire de
la guerre de 1936-1939, le Gouvernement «exprime aussi le désir que le 50eme
anniversaire de la guerre civile scelle définitivement la réconciliation des
Espagnols et leur intégration irréversible»
[22].
Les leaders socialistes du Gouvernement semblent très
soucieux de maintenir le climat relativiste nécessaire au triomphe de leur
néo-révolution. Ils emploient à tout propos des mots ambigus comme
réconciliation, tolérance, consensus, pluralisme. Sous le couvert de ces
mots-talismans, ils veulent abattre les barrières qui séparent les deux
Espagne : l'une, traditionnelle et catholique; l'autre, révolutionnaire et
athée.
Ils cherchent ainsi à transformer l'Espagne en une nation
avilie, sans principes ni idéaux définis, dont les habitants seraient
devenus indifférents à tout. Une Espagne qui aurait renoncé au «que votre
oui soit oui, que votre non soit non» de Notre Seigneur Jésus-Christ et
adopté le «ni oui ni non», le «peut-être» du relativisme moderne.
Javier Solana, ministre de la Culture, constate avec
préoccupation que «le problème des deux mentalités en Espagne n’est pas
terminé». D'après lui, «tant qu'on ne l’aura pas résolu, on n’aura pas
résolu le problème fondamental»
[23].
Pourquoi ? Parce que dans la mesure où cette Espagne du
«peut-être» gagnera du terrain dans les esprits, les projets
révolutionnaires les plus radicaux seront possibles, à condition que leurs
promoteurs prennent le soin d'avancer sans réveiller les Espagnols
narcotisés.
4. Le socialisme affecte de renoncer à ses «dogmes»
Dans le climat relativiste ainsi créé, le socialisme a mis
lui aussi une sourdine à ses anciens dogmes, pour s'adapter à l'ambiance
générale
[24].
Alfonso Guerra, s'adressant à des dirigeants socialistes,
reconnaissait qu’«aujourd'hui commence à se répandre la conscience de ce que
certaines des vieilles formulations de la pensée socialiste se sont
transformées avec le temps en des clichés périmés» . Il soulignait que le
marxisme aujourd'hui «a cessé d’être un texte idéologique clair» et
concluait : «heureusement, nous sommes en train de sortir librement (...) du
dogmatisme»
[25].
5. «Un pays à la sieste»
En conséquence de divers facteurs, comme le relativisme
croissant, l'appauvrissement du débat doctrinal et le désir immodéré de «ne
pas s'en faire», l'Espagnol commun s'est replié sur ses intérêts privés, en
se désintéressant des grands thèmes qui engagent le destin du pays.
Dans le climat de joyeuse insouciance qui s'est ainsi
établi, le sens moral des Espagnols s'est graduellement détérioré,
permettant au socialisme de porter les coups les plus audacieux de sa
révolution culturelle, sans craindre aucune réaction populaire d'envergure.
L'universitaire Alejandro Munoz Alonso fait observer à ce
sujet : «L'Espagne semble avoir redécouvert l'indolence. (...) Nos
gouvernants socialistes ont eu l'habileté de faire jouer l'énorme dépôt
d'aboulie conformiste que ce peuple abrite en son sein (...) L'Espagne est
en train de vivre une énorme sieste (...) disposée à tout traverser, à tout
supporter du moment qu'on la laisse dans sa somnolence. (...) Notre pays
semble plongé dans la léthargie la plus absolue. (...) Le PSOE a réussi
(...) à mettre le pays à la sieste»
[26].
Partant d'un point de vue idéologique très différent,
Julio Ceron constate la même chose : «le phénomène espagnol le plus
extraordinaire, c'est l'atonie (...) de la population»
[27].
6. Une apathie produite artificiellement
En analysant la situation actuelle, nous observons un
phénomène sans précédent dans l'Histoire espagnole : rien, d'aussi grave que
ce soit, ne parvient à impressionner sérieusement le public. Or, il est
anormal qu'un peuple doté de réflexes psychologiques très vifs et d'un sens
aigu de la réalité éprouve une telle difficulté à juger et à réagir.
Alfonso Guerra lui-même, l'un des promoteurs les plus
actifs de la révolution socialiste, n'a pas hésité à proclamer l'importance
de cette apathie dans les plans du socialisme. Nous avons déjà vu que,
d'après lui, le PSOE est en train d'opérer une révolution «terrible» et
«effarante». S'il en est ainsi, pareille révolution devrait attirer
énormément l'attention et provoquer de grandes réactions dans l'opinion
publique. On ne saurait attendre d'autres conséquences d'un phénomène
«terrible» et «effarant» d'envergure nationale. Néanmoins, on ne voit que de
rares et faibles réactions. Une fois de plus, voyons ce que dit Guerra :
«nous ne nous en sommes pas rendus compte, ou presque». Satisfait, il
conclut : «cela vaut mieux». En effet, l'Espagne se trouve comme
anesthésiée, ce qui permet au socialisme de la transformer complètement sans
qu'elle s'en aperçoive.
Plusieurs personnalités ont pourtant signalé ce mystérieux
phénomène.
«
Le journaliste Ramon Pi met en relation l'«anesthésie
sociale» avec l'objectif socialiste de rester longtemps au pouvoir : «Si nos
considérations dans ces colonnes s'ajustaient bien à la réalité (...) à
propos de l'action systématique du PSOE au pouvoir, visant l'anesthésie
sociale pour garantir sa propre permanence, il faudra convenir que les
résultats du 22 juin 1986 correspondent avec une grande exactitude à nos
dénonciations»
[29].
Ces commentaires laissent en suspens certaines questions
capitales. Comment peut-on anesthésier une société ? Est-il possible de
faire cesser l'effet de l'anesthésie ? Que se passera-t-il quand le corps
social se rendra compte des transformations opérées pendant son sommeil ?
C'est précisément à ces questions que le livre de
TFP-Covadonga vient apporter une réponse.
7. Le relativisme, facteur de paix ou de désordre ?
Ecartons une objection primaire : combattre le relativisme
- et par extension la prétendue réconciliation et la tolérance - n'est-ce
pas travailler à la division et à la guerre ?
Quand l'homme relativise ses principes et ses moeurs, ses
modes de vie ne survivent qu'aussi longtemps qu'ils ne lui apportent aucune
gêne. Il s'adaptera au consensus général, parce que rien ne lui coûte autant
que de résister à l'opinion supposée unanime de ses semblables. Puisque la
révolution culturelle donne à ce consensus des tonalités chaque fois plus
libertaires et égalitaires, l'Espagnol relativiste sera entraîné chaque fois
plus loin dans cette direction.
Au terme de cette dérive révolutionnaire, la victime du
consensus ne se soumettra à aucune loi. Elle sera tyrannisée par ses
instincts. Elle sera incapable de vivre dans une société modelée selon les
principes de la morale chrétienne. Elle s'efforcera de détruire toutes les
institutions qui lui apparaîtront comme oppressives de qui souhaite mener
une vie complètement libre et ludique, à la manière d'un faune.
On verra alors disparaître les structures et les moeurs
qui protègent l'ordre social. La situation ainsi créée sera-t-elle la paix
ou le bouillon de culture de conflits continuels ?
La paix fleurit dans une autre ambiance. D'après la
concise définition de Saint Augustin, la paix est la «tranquillité de
l'ordre» (XIX, De Civitate Dei, c. 13). Cherchons donc l'ordre, et nous
aurons la paix.
* * *
Analysées sous l'angle de la révolution culturelle, de
nombreuses situations apparemment sans lien entre elles prennent une
signification et une importance inattendues : elles dessinent les contours
d'un plan de démolition radicale de l'Espagne traditionnelle et catholique.
C'est ce dont nous allons traiter maintenant.
Des socialistes qui acceptent la Monarchie…
Le PSOE a toujours considéré la Monarchie comme un
obstacle à supprimer. «Nous ne sommes pas monarchistes – disait Pablo
Iglesias - parce que nous ne pouvons pas l’être; qui aspire à supprimer le
roi de l'entreprise ne saurait en admettre un ailleurs» (apud
Memoria-Gestion de la Comision Ejecutiva Federal, XXVIIIe Congrès du PSOE,
1979, p. 90).
Plus récemment, Negrin dit encore : «Aucun Espagnol
patriote et connaisseur de notre histoire ne peut être monarchiste, sauf
aberration mentale fondamentale. Ce sont les Habsbourgs et les Bourbons qui
ont mené l'Espagne à la ruine» (apud Emilio Romero, Tragicomedia de España,
Planeta, Barcelone, 1985, pp. 48-50).
Aujourd'hui, les chefs du PSOE, comme ceux du PCE,
adoptent vis-à-vis de la Monarchie et du Roi une attitude complètement
différente. Guerra en est arrivé à dire: «Tous les Espagnols, et
spécialement les hommes politiques, nous devons avoir un soin extrême à
défendre la haute institution de la Couronne» (ABC, 26-1-85). D'ailleurs, la
Monarchie compte maintenant avec le soutien de la gauche et entretient avec
elle des relations ostensiblement cordiales.
D'autre part, il est indéniable que les forces politiques
révolutionnaires – qui demeurent intrinsèquement républicaines parce que
radicalement égalitaires – ont des plans à long terme.
Quels sont ces plans ? Quels en sont les mobiles ?
Une image qui suggère une sensation d'ordre
La présence de la monarchie dans le panorama espagnol
diffuse dans les milieux les plus divers un arome de tradition, une lumière
ténue du passé, une impression de stabilité qui a pour effet d'endormir les
esprits devant l'oeuvre révolutionnaire graduelle du socialisme. La plupart
des Espagnols ont peine à croire qu'une «terrible» révolution puisse être en
cours pendant que Leurs Majestés inaugurent des oeuvres, patronnent des
récitals, donnent audience en leur palais ou réalisent de brillantes visites
officielles à l'étranger.
Naturellement, les socialistes veulent que les déjà
discrètes notes catholiques et traditionnelles de la monarchie s'évaporent
peu à peu, et avec elles l'institution elle-même.
La Monarchie ne devra être qu'un «organe de plus dans
l'État», qui «commence par se faire pardonner d'être monarchie» (Garcia
Escudero, A vuelta con las dos Españas, BAC, Madrid, 1979, pp. 68-71). Un
journaliste a appelé ses nouveaux partisans les «monarquipublicains» (ABC,
21/5/86) et Emilio Romero les désigne comme des «monarchistes d'alambic ou
d'éprouvette, et non de conscience ou d'admiration» (op.cit, p. 20).
L'objectif socialiste
Pablo Castellano, quand il était encore une figure en vue
du PSOE, montrait que du point de vue socialiste la démocratie et la
monarchie sont incompatibles : «Démocratie et république sont des termes
absolument inséparables». Il traçait ce programme : «quand la démocratie
sera bien assise, vécue dans l'esprit de tous (...) et mise en pratique par
toutes et chacune des institutions jusque dans ses dernières conséquences,
elle donnera un seul et unique résultat, qui s'appellera la république» (El
Alcazar, 16/4/85).
NOTES
[1] Le Monde, 7/2/86.
[2] Sandro Viola, «Spagna saggia ed europea», in La Repubblica,
1/5/85.
[3] «Le Parlement dort», in
ABC, 5/6/86.
[4] «Le
silence», in ABC, 1/7/86.
[5] Apud
Juan José Morato, El Partido Socialista Obrero, Ayuso, Madrid, 1976, p. 162.
[6] Dans cette assemblée, la
proposition suivante l'a emporté, à 123 voix contre 113: «Nous reconnaissons
humblement et demandons pardon de n'avoir pas toujours su être de véritables
'ministres de réconciliation' au sein de notre peuple, divisé par une guerre
entre frères» (Secrétariat National du Clergé, Assemblée Conjointe
Evêques-Prêtres, BAC, Madrid, 1971, p. 171).
[7] Ce n'est pas sans raison
que l'Eglise se donne le qualificatif de militante : «Les justes abominent
les impies, et les impies abominent ceux qui suivent le bon chemin» (Prov.
XXIX, 27). Inimitié mutuelle qui été établie par Dieu lui-même –
irréconciliable et toute divine –, comme l'enseigne Saint Louis-Marie
Grignion de Montfort en analysant ce passage de l'Ecriture : «Je mettrai une
inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne» (Gen.
III, 15).
[8] Déjà en 1967 une
déclaration officielle du PSOE exprimait sa joie et ses espérances devant la
démolition des barrières antisocialistes dans les milieux catholiques. Elle
attribue le fait à un changement d'attitudes survenu sous les pontificats de
Jean XXIII et Paul VI, et au climat créé par le Concile Vatican II : «le
PSOE reconnaît l'énorme distance de ton et de propos qui sépare le texte de
l'Encyclique Nostis et Nobiscum, donnée au monde par Pie IX (...) et le
texte réaliste, si rempli d'espoir, de Populorum Progressio (...). L'Eglise
a pris conscience des questions sociales avec retard et avec dommages. Elle
commence par condamner le socialisme dans Nostis et Nobiscum, dans Quanta
Cura et le Syllabus, avec Pie IX (...). Léon XIII continue le combat (...).
Jean XXIII dans Mater et Magistra parle de socialisation avec le cordial
respect qui caractérise ce Pontife. (...)
Quelle différence entre le ton
imprécatoire du Syllabus et le climat d'aggiornamento serein et réaliste de
Pacem in Terris ! Ce n'est pas le moment de réaviver les récriminations,
mais la compréhension. (...) C'est dans cet esprit que le Concile Vatican II
a commencé ses travaux. Le fruit en a été la conjoncture d'une Eglise
rénovée. (...) Cela permet de penser honorablement que les problèmes qui
auparavant avaient été cause d'inimitié et de guerre ont disparu (...). Il
est évident qu'il est urgent d'arriver à une fin heureuse par le chemin
raisonnable de la collaboration.»
Le PSOE continue : «Entre Nostis et
Nobiscum de Pie IX (...) et l'affirmation conciliaire faite dans Gaudium et
Spes (...) il existe l'énorme distance spirituelle qui peut tenir entre une
injuste et colérique condamnation et une mutuelle attitude de sourire et de
mains ouvertes.»
Finalement, le Parti Socialiste se montre satisfait des perspectives que le
rapprochement catholico-socialiste laissait entrevoir : «Le PSOE a la
conviction que l'Espagne qui succédera à la dictature du général Franco
(...) consolidera son propos de rénovation progressiste avec un
rapprochement des catholiques et des socialistes, collaborateurs pour la
création d'un avenir commun. Avenir qu'ils construiront jour après jour, par
la détermination socialiste, elle aussi oecuménique, et par la présence dans
le monde espagnol d'une Eglise qui (...) se déconstantinise» (apud M.
Azcarate, Los marxistas y la religion, Ed.
Cuadernos para el
Dialogo, Madrid, 1977, pp. 157-160, 167).
Le PCE a manifesté la
même satisfaction. A
partir de 1956, il a commencé à travailler à la réconciliation, trouvant
pour cette tâche des compagnons de route inespérés. Voyons par exemple ce
qu'en dit le communiste Ignacio Gallego : «L'unique langage compréhensible
aujourd'hui est celui de la réconciliation nationale. C'est le langage que
nous les communistes avons employé depuis de nombreuses années. C'est le
langage que l'Eglise fait sien aujourd'hui (...) En 1956 (...) le Parti
Communiste déclarait: (...) le Parti Communiste déclare solennellement être
disposé à contribuer sans réserves à la réconciliation nationale des
Espagnols, à en finir avec la division ouverte par la guerre civile (...) La
classe ouvrière, les étudiants (...) de larges secteurs catholiques, ont
reconnu le mérite d'un parti qui, persécuté (...) donnait un exemple de
maturité et de générosité (...) Et l'Église ? Elle était parcourue à
l’intérieur par des courants rénovateurs. Nous les avons suivis avec intérêt
et sympathie (...) Tout change dans la vie et, heureusement, les faits
montrent que l'Eglise n'échappe pas à cette loi» (Ignacio Gallego,
Desarrollo del Partido Comunista, Ebro, Paris, 1976, pp. 224-226).
[9]
Vida Nueva, 8/3/86.
[10] In
J. Linz y otros, España : un presente para el futuro, Instituto de Estudios
Economicos, Madrid, 1984, vol. 1, p. 212.
[11] Ya, 22/8/81.
[12] Mgr Elias Yanes a affirmé
: «En remontant un peu l'Histoire, il faudrait analyser ce qui ressort de la
doctrine sociale, surtout à partir de Jean XXIII. La preuve que cette
doctrine est bien là, c'est que son message a influé de telle façon qu'une
grande partie de l'électorat, surtout chez les gens simples, a voté pour le
Parti Socialiste» (Diario 16, 25/10/83).
Et aussi : «Il y a des décisions
politiques qui ont un aspect moral - a fait encore observer l'archevêque de
Sarragosse - sur lesquelles l'Eglise a une influence auprès de l'électorat
impossible à éluder. Il conclut : il n'y a aucun doute que cette influence a
joué en ce que les catholiques aient voté pour le socialisme» (Ideal,
25/10/83).
[13]
ABC, 21/6/86.
[14]
Jorge Verstrynge, La normalizacion democratica (Elementos para la salida del
siglo), Alianza Popular, Madrid, 1982, pp. 10, 12, 14.
[15]
ABC, 18/3/85.
[16]
Diario 16, 22/2/87.
[17]
Ibid.
[18]
ABC, 21/6/86.
[19]
ABC, 4/1/87.
[20]
El Pais, 22/3/86.
[21]
José Maria Garcia Escudero, A vueltas con las dos Españas, BAC, Madrid,
1979, pp. 173, 189 à 191, 200.
Voir aussi pp. 178-179.
[22] Diario 16, 19/7/86.
[23] ABC, 20/3/83.
[24] Dans ses directives aux
dirigeants socialistes, le XXXIème Congrès du PSOE avertit que, pour remplir
son objectif actuel d'être la «somme des aspirations et revendications de
ces secteurs qui constituent le bloc social progressiste», il faut une
«urgente rénovation idéologique», dont la première caractéristique consiste
à «fuir de tout dogme» (Resoluciones - XXX Congreso del PSOE, Madrid, 13-16
décembre 1984, p. 13). Cela veut dire que le PSOE est intéressé à ce que ses
affiliés n'aient pas de certitudes et soient imprégnés de relativisme, car
les convictions trop rigides des socialistes eux-mêmes représentent un
obstacle sur son chemin.
[25]
Alfonso Guerra y otros, El futuro del socialismo, Ed. Sistema,
Madrid, 1986, pp. 12-à 15.
[26] «La grande sieste nationale», in ABC, 15/9/86.
[27] «Les quatre fronts», in
ABC, 30/1/87.
[28] «Anesthésie», in ABC,
7/11/86.
[29]
«Les effets de l'anesthésie», in Epoca, 30/6/86.
Antérieur Table des matières Suivant
|
|